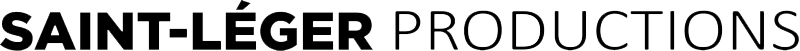Livres
-
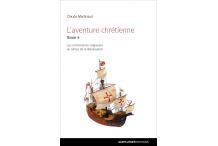
L'AVENTURE CHRÉTIENNE tome 4
Dès la fin du XVe siècle, se dessine une vigoureuse reprise économique et la paix revenue favorise le mouvement intellectuel et l’essor artistique. L’horizon des hommes s’élargit grâce au progrès des techniques, l’Amérique est découverte.
Une vive effervescence intellectuelle se manifeste, dans l’ordre de la connaissance: Humanisme, Renaissance littéraire, comme dans celui de l’art.
Au début du XVIe siècle, le retour en force du sentiment religieux et l’influence de l’humanisme accroissent le désir, déjà ancien d’une réforme de l’Église. Mais cette réforme, aboutira à une fracture de la chrétienté.
En 1517, le moine allemand Martin Luther s’élève contre Rome, et propose un christianisme fondé sur l’autorité de la seule Écriture, Il s’en remet aux seuls princes protestants du soin de diriger les Églises. Les deux tiers de l’Allemagne et la Scandinavie adoptent le luthéranisme. Le Français Jean Calvin donne à la Réforme un nouvel élan.
Au même moment, ; Église catholique entreprend, sa propre réforme fondée sur le renforcement de l’autorité pontificale et sur un très grand renouveau de la vie spirituelle. La lutte contre le protestantisme est engagée. Le Concile de Trente définit la doctrine catholique.
La crise spirituelle se double rapidement de considérations politiques. Les conséquences de la division des chrétiens ont été considérables, tant sur le plan international que sur celui de la vie intérieure des États.22,00 € -
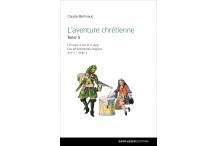
L'AVENTURE CHRÉTIENNE TOME 5
La Réforme tant protestante que catholique a établi en Europe chrétienne une déchirure irréparable. Les nouvelles communautés luthériennes et calvinistes et l’ancienne, catholique romaine, les unes et les autres retranchées de l’Église d’Orient, sont devenues adversaires.
Les États ne sont pas en reste, ils ont pris parti pour l’une ou l’autre foi. En ces temps les questions religieuses et politiques sont encore étroitement imbriquées. Aussi les guerres entre nations et les guerres civiles vont être nombreuses : : guerres de religion en France, arrière-fonds religieux de la guerre de Trente Ans, saignée humaine dans le royaume de France après la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, soulèvements dans le Saint Empire Romain Germanique, contestations en Angleterre ; révoltes aux Pays-Bas…
Progressivement ces guerres laissent place à la controverse virulente : arminiens contre gomaristes appelés aussi contre remontrans , jansénistes contre jésuites…
Sous le coup de boutoir des « lumières », l’Ancien Régime européen fondé sur l’absolutisme et le droit divin est définitivement condamné en Angleterre par les révolutions du 17e siècle, il est ébranlé en France par les philosophes et les écrivains. S’il se maintient ailleurs c’est grâce aux concessions des « despotes éclairés ». En beaucoup de pays, les esprits cultivés s’éveillent à des désirs de changement… la violence religieuse est désavouée.
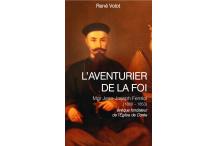
L'AVENTURIER DE LA FOI
Cela est dû à la notoriété de l'un de ses concitoyens : Jean-Baptiste Ferréol, considéré en Corée du sud comme l'un des pères fondateurs de l'église catholique de ce pays.
Jean-Baptiste est né à Cucuron, le 27 décembre 1808. ordonné prêtre à Avignon, il entre aux Missions-étrangères, qui le destinent à la Corée.
Il arrive à Macao au printemps de 1840, échappe à mille dangers et persécutions à l'encontre des chrétiens, se rend en tartarie, puis en Mongolie où il est nommé évêque de Corée, le 31 décembre 1843.
Fin juillet 1845, il ordonne à shanghaï le premier prêtre coréen : André Kim, futur martyr qui deviendra en 1984 saint André Kim.
Monseigneur Ferréol meurt à séoul, le 3 février 1853.
Le respect des Coréens pour Jean- Baptiste Ferréol s'accompagne ainsi d'un vif intérêt pour ce petit village de Provence.
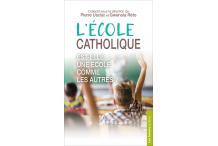
L'ÉCOLE CATHOLIQUE EST-ELLE UNE ÉCOLE COMME LES AUTRES ?
1. Quelle est l’histoire de l’école catholique en France ? Ou quel est le devenir de l’école catholique au fil du temps ?
2. Quels sont les cadres statutaires de l’école catholique ? Ou comment l’école catholique est structurée institutionnellement ?
3. Quels sont les fondements théologiques de l’école catholique ? Ou quelles sont les raisons d’être et les finalités de l’école catholique ?
4. Quelles conformations d’un établissement catholique à l’Evangile ? Ou quelles peuvent être, dans un établissement catholique, les réalisations de la référence constante à l’Evangile et de la vie de foi de l’Eglise ?
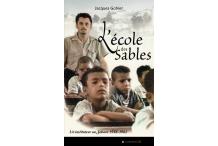
L'ÉCOLE DES SABLES
Il ne cessera d'exorciser cette nostalgie par l'écriture et la plupart de ses ouvrages en sont inspirés.
Quarante-cinq ans plus tard, une rencontre fortuite le plonge à nouveau dans les souvenirs de ce qui fut une grande aventure. L'immensité et la magie envoûtante du désert ! El Oued, la ville aux mille coupoles, lumineuse, mystérieuse… les îlots de verdure dans l'océan de sable, les odeurs mêlées de fleurs et d'épices, la rentrée des classes, les premiers élèves : Tayeb, Mabrouk, Aziza, le cadi de Guémar et bien d'autres... les mémoires de sables du jeune instituteur reprennent vie sur le papier.
Le maître enseigna bien sûr le calcul, la lecture et l'écriture aux enfants de l'oasis mais il apprit plus encore des habitants du souf. Initié aux étranges coutumes, bercé par les incroyables récits, riches d'inoubliables sensations et de chaleureuses rencontres, le jeune instituteur sera plus qu'à son tour un élève curieux et attentif. Ce livre en témoigne et chacun de ses chapitres n'est que le couplet d'un vrai chant de passion pour une terre de légendes.
Jacques Gohier quitta l'Algérie en 1962, rattrapé par ce que l'on nomma longtemps « les événements ». Grain de sable dans la tempête de l'Histoire, le quartz clair de son coeur de vingt ans restera à jamais marqué par ses aventures sahariennes et cette histoire d'amour avec le désert et les enfants de sa classe.
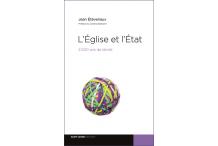
L'EGLISE ET L'ETAT 2000 ans de laïcité
On peut s’étonner que l’Église chrétienne soit devenue une structure de pouvoir et même un pouvoir en elle-même. Le Christ avait pourtant bien précisé : « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 21). On peut même dire qu’il avait désacralisé le pouvoir politique, qui perdait ainsi son caractère absolu en étant relativisé : le gouvernement devenait une affaire purement terrestre, certes concédée par Dieu – « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t’avait été donné d’en haut » (Jn 19, 11) — mais laissée au libre arbitre de l’homme.
Malgré ses imperfections, ses erreurs et ses fautes, l’Église fait figure de boussole chargée de guider l’humanité vers l’amour de Dieu. À ce titre, elle œuvre dans le monde et réclame même qu’une place lui soit reconnue, car elle a besoin d’un minimum de liberté pour conduire son action. Le problème se pose donc inéluctablement de son positionnement dans la société et de ses rapports avec les pouvoirs publics. Comme elle intervient forcément dans la sphère civile, trois grands cas de figure existent : soit elle est persécutée par un pouvoir politique qui ne lui accorde aucune place, soit elle s’assujettit ce pouvoir politique qui devient alors son bras séculier exécutant ses désirs, soit ce pouvoir et elle se reconnaissent mutuellement leur autonomie tout en s’efforçant de collaborer selon des modalités dont existent forcément des milliers de variantes.
Toute l’histoire de l’Église peut donc se résumer aux rapports qu’elle entretient avec le politique. Comme elle ne peut pas être éloignée des réalités terrestres — puisqu’elle est fondée sur l’Incarnation et qu’elle privilégie la méthode de l’inculturation —, elle est présente dans l’histoire personnelle des hommes mais aussi dans celle des peuples et des civilisations. Ses rapports avec l’État, quelque tournure qu’ils prennent, sont inévitables ; elle ne peut pas se confiner dans un splendide isolement et se laver les mains des réalités de ce bas monde : elle n’est pas Ponce Pilate.
Au début du XXe siècle, l’Église catholique, tout en s’efforçant d’entretenir, grâce à sa diplomatie, des relations avec le plus grand nombre d’États, classait le monde selon le degré de liberté qui lui était concédé. Petit à petit s’est développée une sorte d’indifférence plus ou moins polie, qui s’est traduite, en 1947-1948, par l’élimination volontaire de toute référence religieuse lors de l’élaboration, à l’ONU, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et plus récemment encore la criante omission dans la Constitution européenne.
Cette histoire passionnante de la laïcité se lit comme un roman.
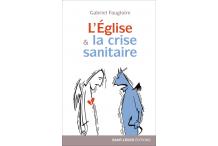
L'ÉGLISE ET LA CRISE SANITAIRE
L’analogie que l’on peut faire entre les évènements et les différentes approches de manipulation et de propagande est troublante.
Comment l’Église s’est-elle positionnée dans cette crise ? Comment peut-elle encore nous aider à combattre les manœuvres mondialistes antichrétiennes qui ne se cachent plus ?
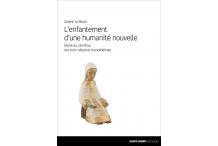
L'ENFANTEMENT D'UNE HUMANITÉ NOUVELLE
Ce texte entend donc démontrer comment les divergences et les incohérences entre les trois traditions monothéistes du point de vue historique s’effacent à travers le prisme d’une lecture du cœur, attentive à la symbolique des comportements de Marie, au carrefour du judaïsme, du christianisme et de l’islam. Elle semble rétablir un équilibre entre la Loi et le cœur, la parole et le silence. Ce qui autorise à favoriser par son intermédiaire de multiples facettes de Dieu au profit d’un dialogue interreligieux symphonique, où chacun des chemins converge vers une quête de la Foi.